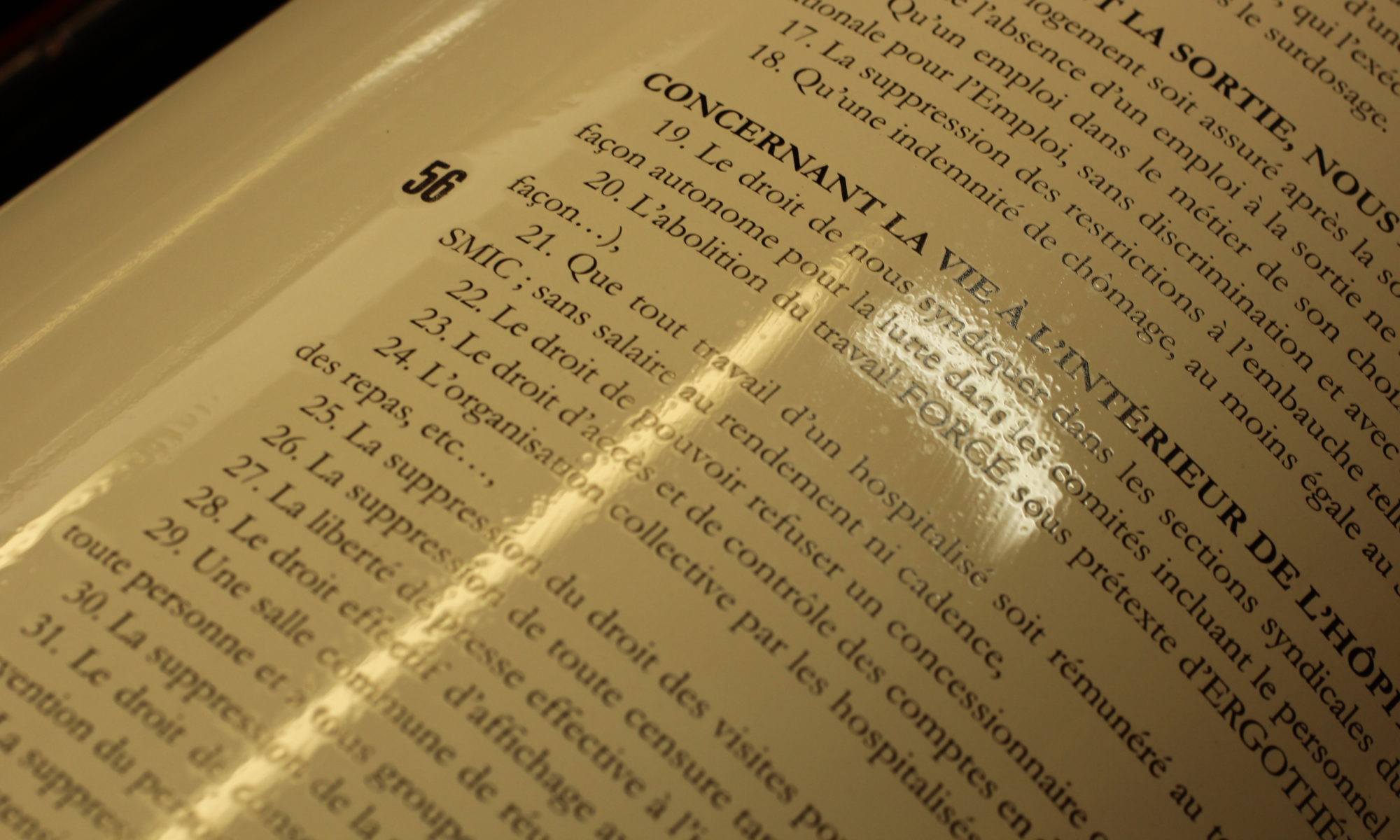J’ai perdu 10 ans de ma vie à l’école, je me suis pas vue grandir, je me verrai pas vieillir non plus. Mes potes verront bien que mes cheveux blanchissent et que mon corps flétrit. Je verrai bien que j’ai des trous de mémoire et un fatras de souvenirs. Mais je n’aurai pas le temps de m’y appesantir, occupée chaque jour par l’écrasante nécessité de vivre.
J’ai perdu 10 ans de ma vie à l’école, je me suis pas vue grandir, je me verrai pas vieillir non plus. Mes potes verront bien que mes cheveux blanchissent et que mon corps flétrit. Je verrai bien que j’ai des trous de mémoire et un fatras de souvenirs. Mais je n’aurai pas le temps de m’y appesantir, occupée chaque jour par l’écrasante nécessité de vivre.
Parfois je me réveille la nuit, je me dresse dans le plumard, en disant d’une voix endormie: « J’ai encore fait un cauchemar« .
Combien de personnes qui partagent mes nuits ont pu voir cette scène, et entendre ce récit…
« J’ai rêvé que je tentais d’échapper à mon père mais qu’il finissait par m’attraper et me mettre en HP. »
Et toujours je constate la présence d’un(e) ami(e) ou d’un lieu sûr, et me rendors, ou alors je me blottis contre mon compagnon, comme pour élargir les parois de la nuit en diluant, dans sa chaleur, l’impact.
C’est un rituel étrange et bref, une mort et une renaissance, un passage de la terreur à la tendresse qui m’échoit parfois par surprise, et que j’accomplis de bonne grâce. Il est doux d’avoir du temps et des amis auprès desquels panser ses plaies. C’est le sens premier que je donne à ma vie, c’est pour ça que je me réveille chaque matin : pour constater que je suis loin des lieux de mes cauchemars, entourée d’êtres qui m’ouvrent un présent plus supportable.
Et puis le temps passe, la nuit s’en va, le jour se lève et j’essaie d’y graver autre chose.
Le rêve revient pourtant, et ma peur inquiète parfois ceux qui en sont témoins.
C’est que moi, l’HP, je suis pas sûre d’en sortir vivante : je tombe déjà dans les pommes si je tire sur un joint, comment pourrais-je tenir le coup sous neuroleptiques ?
Et si je vivais, dans quel état ? Que resterait-il de moi, moi qui fonds en larmes si on me colle une baffe, moi qui me débats et me sauve dès qu’on prétend me séparer trop longtemps des gens que j’aime ? Que resterait-il de moi si je ne pouvais plus dessiner, serrer ma peluche contre moi la nuit, si je ne pouvais plus lire, ni avoir sous mes yeux les quelques objets auxquels je tiens ?
Que vivrais-je, lorsque mes amis me verraient en pyjama hideux, défoncée et impuissante, moi qui aime tant
être super sapée et faire mon intéressante ? Et s’ils ne peuvent me sauver, que leur laisserais-je, que resterait-il de nous ?
Comme si je n’étais pas déjà assez pauvre, assez frustrée, qu’il faille tout me retirer.
Car ce n’est pas juste moi qu’on retirerait du monde. C’est le monde qu’on me confisquerait. C’est moi-même qu’on me retirerait. C’est toute mon histoire, mes rêves, mes espérances, et la façon dont je m’accommode
de moi. C’est les petites cachotteries que j’ai mis en place pour supporter le monde, comme le rêve, la poésie, l’humour.
C’est le mot de la fin, celui que je dois prononcer avec mon dernier souffle, et qui dit : « Mon panache ».
C’est tout ça dont je peux être privée un jour, si j’ai escaladé un mur de trop, si j’ai eu le malheur de tomber à genoux en larmes devant un cheval roué de coups, si j’ai mordu un flic, si j’ai trop souri, trop pleuré, trop ri, si j’ai eu du mal à contenir des choses qui n’auraient pas à l’être.
Je vis sous cette menace, en apnée sous la tranquillité des autres, chaque seconde m’est sursis.
Mes projets tiennent du luxe fantasque.
Il me semble plus réaliste de m’imaginer des épitaphes.
J’en veux des splendides! Quand j’en trouve des bien, je rêve de me les faire tatouer sur la peau.
Ainsi, quand ils m’auront chopée, je pourrai, dans l’interminable corridor du néant, faire faire les cent pas à mon enveloppe charnelle, comme on exhibe obstinément une œuvre à jamais incomprise du public.
Elle sera ma propre sépulture, dernière demeure chimiquement vidée de ma présence.
Mon père me l’a promis, ce dénouement. Il a passé des années à m’apprendre des choses et me donner à manger, pour ça.
Pour l’examen final où je refuse de rentrer dans l’ordre.
Jean-Marie, prends ta fille, ta fille unique, et si elle veut pas bosser pour le système, porte-la sur l’autel de la science.
Et cette fois, on mettra pas un mouton à sa place, ça rigole plus, c’est pour de bon. On a des médicaments qui font passer l’envie de rire.
Je rêve de m’écrire sur les fesses un poème indiquant à quel point j’en ai fait bon usage.
Pour quand ils y planteront l’aiguille.
Mais finalement je n’écris rien sur mon corps. Je ne veux pas porter sur ma vie l’ombre de ma mort.
Je pense des fois à la perplexité des brebis qu’on couche sous une lame. À leurs questions.
« Ne suis-je qu’une viande ? Qu’une fille ? Qu’une main d’œuvre ?
Comment ai-je pu faire taire mes doutes, ne rien dire, ne rien faire, ne tuer personne, jusqu’à ce moment où il est trop tard ?
Comment n’ai-je pas mis le monde en branle, pour donner le change à une telle mesure d’horreur inexplicable, comment ai-je pu laisser mon destin entre ces mains intéressées, et croire à leur bienveillance, pour qu’en ce jour tant de haine nous incombe et me réduise au silence ? Ne suis-je pas un peu jeune, encore, après tout ? » L’amour des parents pour les jeunes, tout ça… Ces concepts que je n’ai jamais vraiment dépassés… Ces concepts que j’ai mis toute une vie à remettre en question envers et contre tout, par amour de la logique…
Ces barrières mentales qu’on appelait des roses et sur lesquelles je me suis déchirée…
Dans quelle faille spatio-temporelle s’évanouissent-elles dans le crâne de mon père, dès lors qu’une autorité prétend se charger de mon cas ?
Je fuis l’imaginaire de cette fin tragique, qui me visite pourtant dans mon sommeil, sous ses formes les plus baroques.
En attendant, j’aménage ma peine. Je sème ma vie de points de suspension, consciente que chaque mot peut
être le dernier. C’est ennuyeux car la vie, pour moi, c’est pas ça, c’est un grand brouillon, un perpétuel réajustement.
Ça devrait être: prendre le temps d’être tout (en passant s’il le faut par n’importe quoi). Pas craindre sans cesse de n’être plus rien.
Je suis l’aboutissement de plusieurs millénaires de civilisation. Je suis la possibilité d’éliminer discrètement de la progéniture qui ne correspond pas aux besoins de son corps social, sans avoir à se donner la peine d’en penser quelque chose.
Quel épilogue apporter à 25 ans d’existence ? Et que dire aux personnes auprès desquelles j’essayais compulsivement de me rendre irremplaçable ?
Dans cette vie au futur conditionnel, j’aurai aimé.
Dans l’hypothèse où mon père ne m’attrape jamais (ou se décide à se faire oublier, seule chose saine dont il soit encore capable), je pense vraiment que je pourrais, moi, faire des trucs géniaux.
Je sais pas encore quoi.
Un truc qui me distingue, un machin merveilleux qui dépasse du couvercle de l’absurde, comme un pantin joyeux qui surgit de sa boîte.
Un truc évident.
Célie.