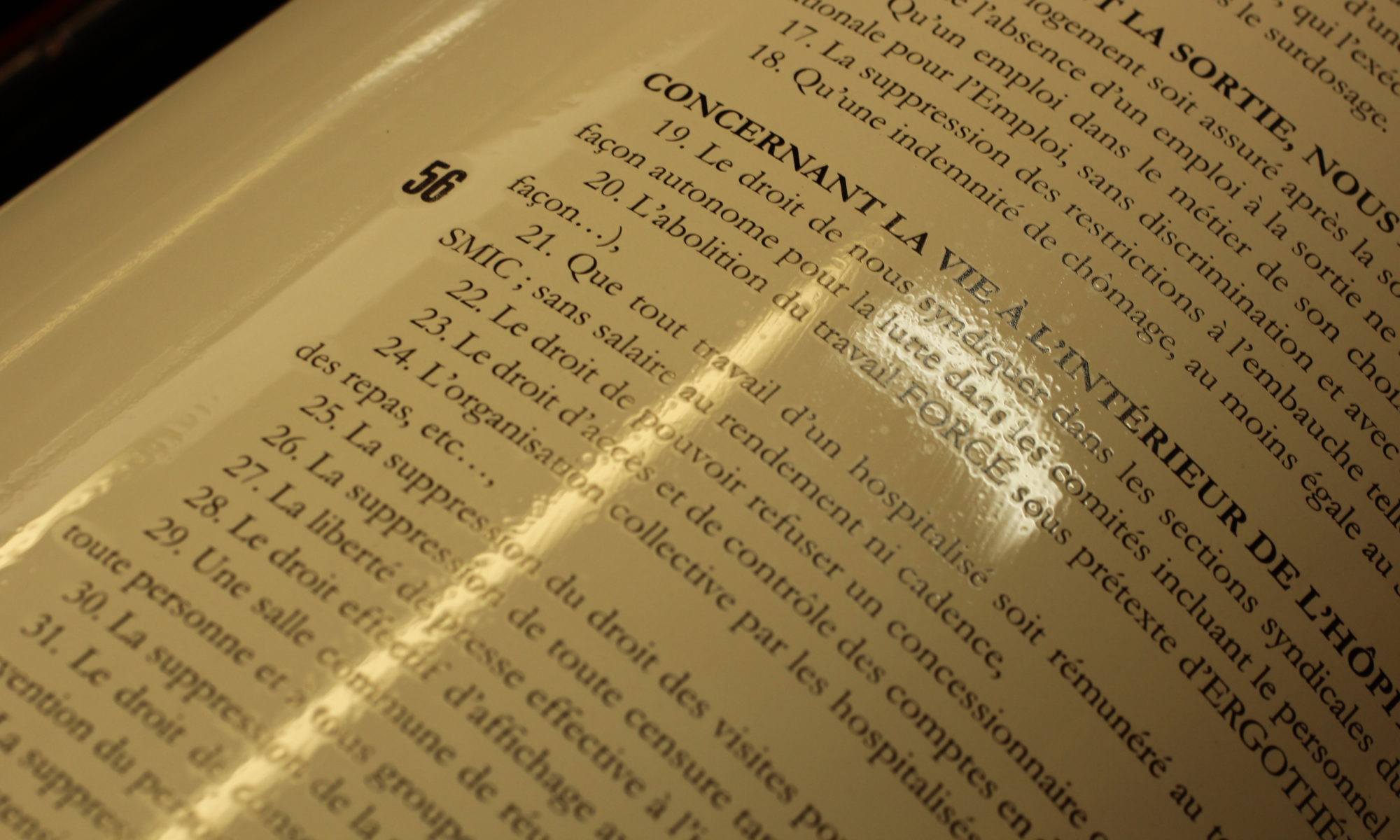Soin : ensemble des moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade moyennant rétribution.
(déf. du Larousse 1930)
Aider : porter secours, seconder, assister. Prêter son concours en prenant soi-même une partie de la peine. (ibid.)
Dans ce témoignage, il est question de la difficulté énorme de construire une relation attentive à ne pas reproduire des mécanismes de domination et de pouvoir avec quelqu’un-e qui est psychiatrisé-e. (1)
Si les souffrances psychiques ont tout l’air de difficultés intimes, voilà (encore) un lieu où « l’intime est politique ». Et les rapports que nous entretenons avec celles et ceux qui font face à ces difficultés sont sans cesse contaminés par le mode opératoire des institutions qui les « prennent en charge » : on en vient vite à prendre une place de soignant-e, à infantiliser l’autre ; à la-le culpabiliser ; à la-le réduire à une seule identité, celle de malade ; à lui interdire un certain nombre de pensées et d’actes ; à la-le contenir physiquement et-ou psychiquement. Même quand on veut « aider »..
 J’ai rencontré il y a plus d’un an V., psychiatrisée en HDT (2). Je travaillais comme intervenante artistique à l’hôpital, cette femme participait aux ateliers que j’animais. J’avais pas mal de présupposés bienveillants et pourris, des questions aussi. Quelque chose comme : les pauvres, ils ont pas de bol (comme si tous les participants de l’atelier allaient être hypersympas et un peu neuneus), et puis aussi, est-ce qu’on va réussir à se comprendre ? (tiens, je ne me pose même pas la question avec d’autres gens). Les médocs, ça fait dormir, ils vont être mous sûrement. Et s’il y a une crise ?
J’ai rencontré il y a plus d’un an V., psychiatrisée en HDT (2). Je travaillais comme intervenante artistique à l’hôpital, cette femme participait aux ateliers que j’animais. J’avais pas mal de présupposés bienveillants et pourris, des questions aussi. Quelque chose comme : les pauvres, ils ont pas de bol (comme si tous les participants de l’atelier allaient être hypersympas et un peu neuneus), et puis aussi, est-ce qu’on va réussir à se comprendre ? (tiens, je ne me pose même pas la question avec d’autres gens). Les médocs, ça fait dormir, ils vont être mous sûrement. Et s’il y a une crise ?
J’arrive avec un projet de poésie. Elle prend la parole pour dire que mon truc est à côté de la plaque parce qu’elle n’arrive plus à lire avec les médocs. C’est une jeune nana, plu- sieurs fois elle est absente aux séances parce qu’elle est « en gayole (3) », ou privée d’activités. Elle pourrait être ma petite sœur. Je crois que le premier truc que j’aime chez elle, c’est son côté direct sans politesse, sa mauvaise humeur, et son rire qui cascade ; rare, et fort.
Ce lieu et tous ses agents me débectent. On a beau m’expliquer, je ne me rends pas à l’évidence des blouses, des mesures d’enfermement, d’hygiène et de distance. Dans cet endroit sensé être conçu pour des gens qui ne se sentent pas bien, je n’arrive pas à tenir plus d’une de- mi-journée sans avoir envie de faire un truc violent ou spectaculairement débile pour habiter le vide tonitruant des pièces-couloirs à la mode morgue. J’ai la rage de voir ce qu’on fait vivre à ces gens. Il faut que je fasse quelque chose, je ne sais foutrement pas quoi. J’ai un peu de temps libre, je décide d’aller rendre visite à V. au pavillon « mimosas » (évidemment, il n’y a à peu près aucun mimosa, mais beau- coup de gens traités comme des plantes vertes). Le parloir ressemble à une salle d’attente, magazines de droite en moins, interphone et surveillance en plus. Elle me raconte son histoire. Peut-être comme elle le ferait à une blouse blanche. Noire de noire depuis la naissance. Je n’arrive pas à penser, j’entends les horreurs de son passé, puis de son « ordinaire ». Je suis touchée par cette avalanche, encore plus par la lutte que ça suppose de vivre avec. On a une violence en commun. Désir très fort de la sauver de cet endroit mortel. Je cherche un moyen d’ouvrir une brèche dans sa fatalité, convaincue qu’elle est que s’il y a une suite à sa vie elle sera de la même couleur merdique. Bleu flic, blanc hosto, rouge pompier et gris partout même dans l’alcool. Qu’est-ce que je peux lui dire ? Je lui tchatche dans le temps trop court qu’on a une suite en vrac de conneries pleines d’espoir, que la vie n’est pas si moche, que les gens ne sont pas tous atroces. Je mélange tout, je lui parle à elle et à moi, puisque c’est à moi que c’est insupportable qu’elle ait envie de mourir. Et puis ça me concerne aussi de chercher des raisons de continuer. De colère en tristesse, mon impuissance se retourne souvent contre moi. Qu’est-ce que c’est que cette histoire que je me raconte que je pourrais la sauver des merdes dans lesquelles je vis aussi, ou la sauver d’elle-même ? L’empathie, j’en ai, et j’ai une idée de mes désespoirs mais je n’ai pas vécu d’être psychiatrisée. Pour sûr je ne peux pas me mettre à sa place, mais la mienne, c’est quoi en fait ?
On vit ensemble d’autres moments à l’atelier, et je repars chez moi, à des kilomètres, amère. Trop tard, je la connais, et sans lui faire de promesses je lui en fais plein. Elle me demande de croire en cette autre partie d’elle, « capable de se tirer et de vivre ».
Des semaines plus tard, je l’appelle, j’ai promis. Elle n’essaye plus de mourir tout le temps, et j’entends des sourires, des bouts d’envies fragiles dans sa voix. Elle a fracassé la gueule d’un gars qui l’a insultée, sa main est en vrac. J’ai envie de la féliciter, et aussi de lui dire de faire gaffe… Finalement, je ne dis pas grand chose, pour n’être ni sa mère, ni celle qui l’encourage à tout faire pour se faire virer, vu qu’à part la rue y’a pas d’endroit où elle peut aller. Et personne d’autre à appeler. On se téléphone.
La plupart du temps, comme on ne se connaît pas bien, on n’a pas grand chose à se dire. Moi, je lui raconte ce que je fais… Souvent je ne suis pas là quand elle appelle, parce que j’ai le droit de me balader.
Elle, enfermée, se fait chier terriblement. On l’a mis dans un « foyer vers l’autonomie ». Je pense que c’est une blague, mais je suis contente pour elle, c’est plus petit, j’ai l’impression, moins pire. Une promesse d’institution vers un appart, une vie un peu plus à elle, elle veut ça et elle veut y croire. Sauf que… Quand je réussis à lui obtenir une perm de trois jours pour son anniversaire, je vois la gueule de la promesse. Ce foyer est pire que l’HP. Au moins, dans le nombre à l’HP, il arrive que t’échappes au flicage cinq minutes ; là, impossible : ils sont juste une dizaine d’adultes pour quatre surveillants. Rien n’est fait pour leur « autonomie » : les relations sexuelles sont interdites, on ne peut inviter personne dans sa chambre, il y a un système de punition, et un travail obligatoire payé à la pièce, les activités sont dans le style « hygiène de vie », sans parler des caméras et autres matons-éducs.
On passe trois jours ensemble. On se marre. Je redécouvre par sa présence ce que c’est de prendre le métro, aller à des concerts, manger des fallafels, aller boire des verres, passer chez des potes… Et elle, à 22 ans, elle n’a jamais fait ça de sa vie. Je jongle entre ne pas me censurer, ni en faire trop, ni devenir une éduc. Elle me raconte un projet dont je ne sais pas si c’est le sien, de travailler avec des enfants ou des animaux. J’ai envie de lui dire que le travail, c’est de la merde. N’importe quoi, je me prends pour la grande initiatrice depuis qu’elle a appris à prendre le métro avec moi.
Et puis je la ramène. J’ai l’estomac troué de la remettre là-dedans.
D’un coup de fil quelque temps plus tard, j’apprends qu’elle a foutu le feu, ce qui la rend tricard de tous les foyers de la région. Pour avoir allumé une boule de PQ dans les chiottes du foyer. Elle est à la rue. A mille bornes, je fais quoi ? Elle me demande de venir la chercher, avec une urgence énorme. Je lui dis que je ne peux rien faire, j’ai pas de thunes, je n’arrête pas ma vie pour aller chercher quelqu’un, et surtout, je flippe. Moi, seule, vivre avec elle ? Pas moyen. La laisser dehors ? Pas moyen non plus. Je fais le lien avec la seule personne de sa famille. Je me retrouve à faire le taf d’une pétasse d’assistante sociale (celle qui a décidé de ne plus la supporter et de la « punir » en lui empêchant un placement) : je joins tout le monde, je récupère l’ordonnance… Ça marche un temps, mais V. se sent trop fragile, et ne veut pas rester chez sa tante, elle décide de retourner à l’HP. Un des seuls « choix » qui lui appartienne. Aujourd’hui, elle est encore à l’HP, vu qu’elle a passé sa vie en foyer, et qu’elle n’est pas assez « autonome », le seul projet qui lui reste est de trouver une place en famille d’accueil. En attendant, depuis six mois, elle demande à aller souvent en isolement, tellement elle pète les plombs de subir le collectif obligatoire (inter- diction d’aller dans sa chambre la journée en HP), et du coup, bizarrement, son traitement a ré-augmenté. Mais attention, ce n’est pas l’absence d’avenir ou la surenchère de « soins » qui y est pour quoi que ce soit, non, tout ça c’est sa « maladie ». Comme dirait l’infirmière.
Je ramène V. après une perm, l’infirmière se tourne vers moi : « ça s’est bien passé ? », sans regarder V. une seconde.
J’ai comme l’envie de lui démolir sa gueule et celle de ses collègues, mais je ne le fais pas.
Pour V., je suis la personne « alternative » à l’institution, car je ne suis ni de sa famille, ni du métier, et j’ai la possibilité sur simple courrier de lui obtenir des permissions de sortie. Du coup, c’est compliqué, parce que je suis un bricolage de tout ça et c’est surtout pas ce que je souhaite, parce que je me sens égoïste quand je ne peux ou ne veux pas. Pourtant le pire serait que je me sacrifie, que je lui offre un mensonge en amitié.
En tous cas, c’est là, toujours : elle est enfermée. De mon côté, je lutte contre ma volonté de me changer pour elle (autocensure et surveillance de mes paroles surtout) de la porter, de la considérer avant tout comme fragile, d’anticiper ses comportements, d’avoir peur d’une crise, de la sortir des médicaments, de lui im- poser mon rapport au monde…
De son côté, elle a tendance à se fliquer quand elle est avec moi, parce qu’on lui a appris que si elle veut obtenir quelque chose, elle doit « bien se comporter », c’est-à-dire se soumettre aux propositions d’activités, ne pas se mettre en colère, ne pas causer de problèmes…
Bref, on joue nos putains de rôles.
Pourtant, aucune identité ne peut tout-à-fait nous contenir : elle n’est ni résumable à une psychiatrisée ou une véner, ou une « jeune fille dé- favorisée »… Ni moi résumable à un soutien, ou une calme, ou une éducation bourgeoise… Il n’y a aucune case sociotruc qui raconte ces mélanges qui nous constituent, parfois dictés par l’extérieur, parfois choisis. Je préfèrerais multiplier mes appartenances par affinités, et me choisir des mots à moi. Elle est considérée comme malade, enfermée, c’est son quotidien et elle se vit souvent comme ça (être malade, c’est une affaire de survie de le reconnaître au moins un peu à l’HP), moi je suis considérée comme normale et dehors, et je ne me vis pas vraiment comme ça.
On essaye de construire du commun, et y’en a, dans le refus de la tenue comportementale exigée par exemple. Mais l’asymétrie de nos vies fait du bancal dans nos rapports. Je suis là, parfois, pas toujours. Les potes me prêtent leurs voitures, leurs apparts et leurs oreilles… Sans quoi, se voir serait impossible.
On bricole.
Je ne te sauverai de rien, c’est mon cadeau à nous deux.
Mais si tu veux te battre, on se bat ensemble.
O.
Notes :
(1) Ce terme est issu de l’antipsychiatrie, je l’utilise ici pour nommer autrement que le médical une personne ayant été soumise au pouvoir psychiatrique. (retour au texte)
(2) Hospitalisation à la Demande d’un Tiers (signée par sa tante). (retour au texte)
(3) Les psychiatrisé-e-s de cet HP utilisent ce mot du patois picard qui signifie « geôle ». (retour au texte)