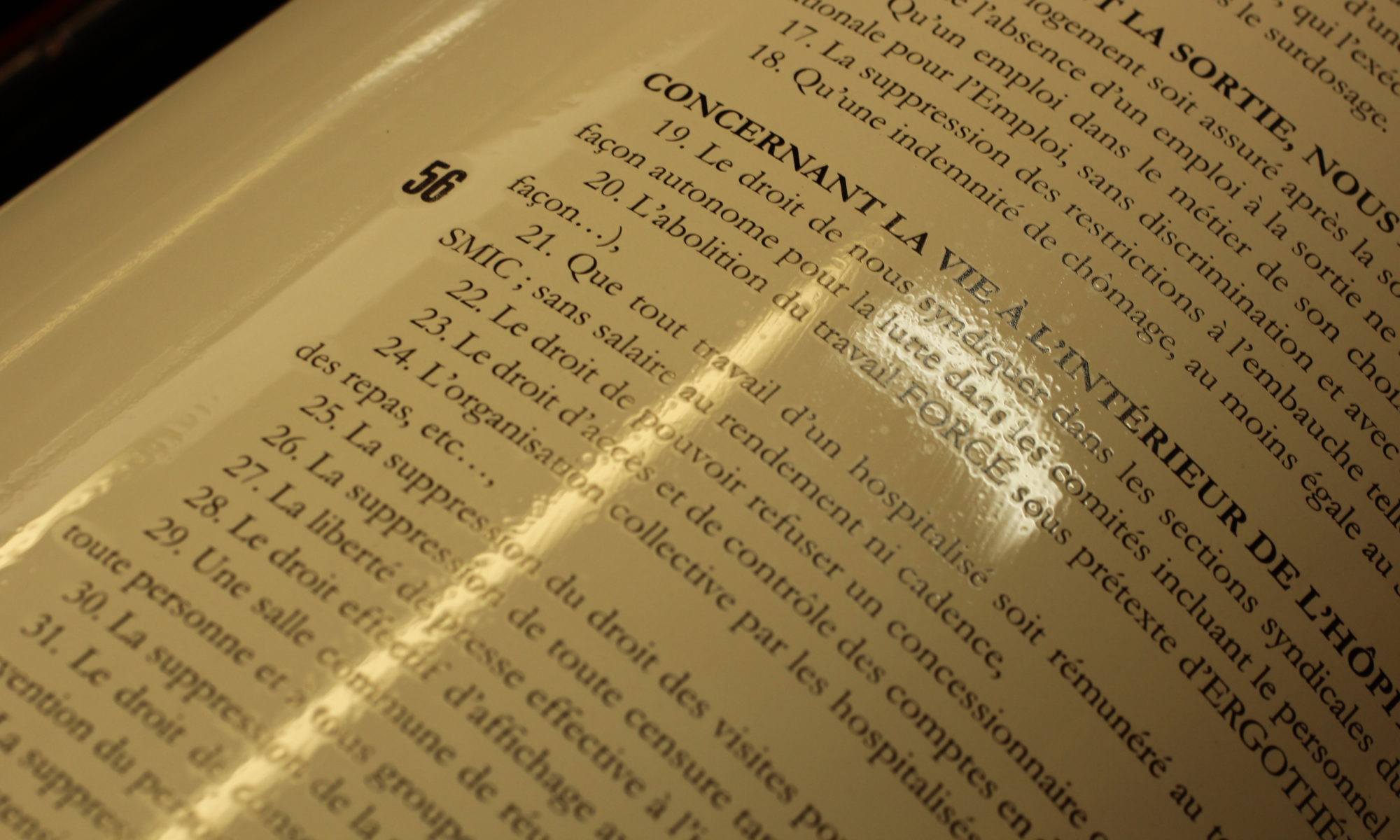J’ai été hospitalisée le 19 novembre 2007, sous le régime de l’hospitalisation libre. Être libre de s’enfermer, quelle aubaine, c’est une idée géniale. Ce séjour était le deuxième. Un séjour de rêve – une grande bouffée de volupté.
Impossible de choisir où je vais atterrir cette nuit. Ce ne sera pas sur un terrain mou. Certains ont déjà choisi la destination. Le chemin est long, en ambulance. De la nuit et des lumières alarmantes : gyrophares, néons dans la cabine qui me transporte… Je n’avais choisi que l’abandon de mes sens à un long sommeil mais on m’a réveillée en plein rêve d’oubli. Je n’aime pas qu’on me réveille pour ces conneries : s’habituer, s’adapter, vivre comme n’importe qui d’autre.
 « On va vous envoyer dans un endroit où vous allez pouvoir vous reposer, faire le point. » Tu parles ; le repos mon cul, l’ennui qui dégouline et le point, re-mon cul, explosions, traits malmenés, enragement. Heureusement j’ai parfois rigolé.
« On va vous envoyer dans un endroit où vous allez pouvoir vous reposer, faire le point. » Tu parles ; le repos mon cul, l’ennui qui dégouline et le point, re-mon cul, explosions, traits malmenés, enragement. Heureusement j’ai parfois rigolé.
Arrivée dans mon pavillon 26 à l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif : dans la salle du bas. Une table de ping-pong, un baby-foot, des tables, des plantes merdiques, encore des néons et une infirmière. Je comprends de moins en moins. On m’aurait embarquée dans une colonie de vacances ?
Le bruit que je passerai mon temps à espérer et détester en même temps fait son entrée : les clefs s’entrechoquent, le verrou est débloqué, la porte s’ouvre, la porte claque, la porte est fermée à clefs. Ça tinte, ça claque, ça glisse, ça reclaque, ça t’enferme.
Dans même pas quarante-huit heures je n’essaierai même plus d’ouvrir une porte pour aller d’un endroit à un autre. Devant une porte je ne sors plus les mains de mes poches. Je sais qu’elle est fermée. Tout est fermé ici. Les portes, les fenêtres, les stores, les radiateurs, les chambres, les armoires. Ils ont peur que l’ennui dégouline hors les murs ? Que la folie cadenassée ne se mette à battre le pavé ? Pas de pavé pour les dingues. Des portes verrouillées et des nantis qui ont les clefs. Nous montons – premier étage du pavillon – je suis en larmes, j’ai encore plus envie de crever qu’il y a douze heures. Je quitte ma sœur et son mec, je quitte mes vêtements, mes affaires, mes clopes, mon stylo, mon cahier, mon téléphone. Les revoir sera une entreprise compliquée.
Nous sommes alors le 20 novembre déjà. Je suis habillée en pyjama bleu, dix fois trop grand. J’ai tant pleuré que j’ai encore plus envie de fumer.
« C’est pas possible mademoiselle ». J’apprendrai vite que rien n’est possible ici, ou pas grand chose. « Et c’est possible de vous foutre mon poing dans la gueule ? » je pense déjà. Après une journée entre hôpital, larmes, ambulances, noir compact, dégueulade, je ne peux pas fumer ? J’aurais mieux fait de crever, j’aurais fumé des clopes au goût de nuage et pas senti cette odeur de mépris…
Nuit très courte. Réveil en fanfare. Pour que je me lève, une infirmière arrache ma couverture. Ainsi j’ai froid et je ne reste pas longtemps allongée. Je me cacherais bien sous le matelas mais je ne crois pas qu’on aime les blagues ici. Ça rigole pas quoi !
Je me dirige vers la salle de réfectoire – qui est en fait salle de tout – et là j’hallucine. Appuyée contre un mur, je découvre mes nouveaux potes, prêts à petit-déjeuner. Certains. D’autres font en- core la queue à la station-service.
Station-service : chariot rempli de boîtes, carafes, verres, liquides colorés, piluliers… surveillé de près par une infirmière. Les médocs. Chacun son carburant. Passage obligatoire. Je n’ai encore vu aucun médecin. J’échappe à cette étape. Pas pour longtemps !
J’ai une tête de dessous de bras, une gueule en papier mâché, les pieds nus, les seins presqu’à l’air. Je dois tenir mon futal de pyjama pour pas me retrouver complètement à poil. La veste est tellement grande que le bouton du haut arrive un peu au-dessus du nombril. Joyeux décolleté ! Et sinon, nue. Je vais rester comme cela quatre jours. Sans chaussettes (ils me trouveront des espadrilles dix fois trop grandes elles aussi dans deux jours). Je tiens mon futal. Je cache tant bien que mal ma poitrine. Ça va être pratique de manger !
Personne ne me propose de douche. Personne ne me parle. Je me remets à pleurer. Je me remettrai souvent à pleurer. Ou à gueuler. Cracher sa hyène. Et plus souvent pour des raisons inhérentes au système hospitalier qu’à mon système que je sens fragile et défaillant.
Au-delà de l’angoisse qui m’habite, c’est la douleur du corps qui me détruit le plus ces premiers jours. J’ai froid. Tout le temps. La journée, juste ce putain de pyjama. Quand on peut enfin sortir le premier jour pour fumer une clope, c’est pieds nus que je déboule dehors, flottant dans le XXL réglementaire. Sol en béton froid, murs en béton, rage en béton armé, dé- sespoir en matière inoxydable. Les gardes – euh pardon – les personnels soignants passent leur temps à nous compter et nous fermer les portes au nez. « Vous irez fumer quand on aura pris notre petit-déjeuner [ils n’ont pas de café chez eux ?], fumé nos clopes, fermé les chambres, repris un café, refumé un clope… » La liste est longue. Pendant ce temps c’est le défilé aux chiottes (un seul pour vingt personnes hospitalisées) pour fumer. On y va à deux, trois, pour que tout le monde puisse passer. Mecs, meufs, ensemble dans cet espace qui pue plus la fumée que la pisse au fur et à mesure que l’attente se prolonge. Pour nous dissuader, une affiche représentant une cigarette et tous ses composants poisons est collée sur la porte des toilettes. Morts de rire ! Et ils nous bassinent avec le « c’est interdit de fumer dans les lieux publics, à l’hôpital, c’est pas bon pour la santé… » Et ta sale gueule qui m’impose de prendre des sales médocs, elle n’est pas bonne pour ma santé non plus. Argument suprême : vous n’avez pas le droit de vous enfermer dans les chiottes à plusieurs, encore plus si mecs et meufs se mélangent. Pas de relations sexuelles ici, c’est interdit, c’est aussi mauvais pour la santé ?
Un jour, je sors avec un pote des chiottes, on venait de fumer. Une infirmière nous cueille à la sortie et mon pote devance la réprimande : « Ne vous inquiétez pas, on n’a pas fumé, avec Melle I. c’est purement sexuel ! ». Morts de rire, l’autre fait une tronche de six pieds de long. Elle en réfère. Entretien avec la psychiatre le lendemain pour tous les deux (on a la même) et question : « Quels sont vos rapports avec Monsieur C. ? » et pareil pour mon pote : « Quels rapports entretenez-vous avec Melle I. ? ». Elle y avait cru. Ici le second degré existe très rarement, l’humour je l’ai déjà dit, est banni.
Donc pas de cul. Et comme on est en chambre de trois, pas moyen de se masturber tranquille ! Range ta libido, range tes envies, range ta vie, nettoie-toi de tes idées morbides morveuses et tu te sentiras tellement mieux !
Je reste avec le corps. Pendant trois jours, je réclame au moins une culotte et mon soutien- gorge. Je leur aurais demandé un flingue j’aurais peut-être eu plus de chance. Non pas possible, c’est encore dangereux. Dangereux ? Ah oui je peux me pendre avec mon soutien-gorge (55 kgs au bout d’un morceau de dentelle, ça promet) voire me crever un œil avec une baleine et je vais fumer ma culotte peut-être ? J’en peux déjà plus, j’ai mal aux seins, je me sens moche, vulnérable, j’ai mal au bide, d’angoisse, j’ai froid.
Il me faut attendre que ma mère ait droit à une visite pour que je récupère mes habits. Je dois être présentable tout de même ! Habits du dimanche ! Flonflons ! Une fois la visite terminée, pyjama. Rideau. Le spectacle est fini. Coulisses. La tenue de scène est rangée au pla- card (inaccessible) des infirmiers.
Finalement je vais pouvoir m’habiller en civil. Au bout de ces quelques jours. Récompense, bonne conduite, hasard, décision arbitraire… je ne sais pas mais j’ai pris une douche brûlante et remets des vêtements familiers.
Les petites douleurs du corps se succèdent en s’empilant. Quand la pile est trop conséquente, ça énerve. Pas possible de se laver les dents après le petit-déjeuner, on est parqué dans la salle commune et on attend le Père-Noël ou je ne sais qui d’autre. Pas possible de se reposer sauf recroquevillé sur des vieux sièges encore dans cette salle commune ou (c’est ma place) sur un radiateur qui scie les fesses, comme un gros chat. Cela sera possible jusqu’à ce que la chaudière pète. On avait froid.Maintenant on est transis. Pas de couverture supplémentaire disponible, plus de sieste sur le radiateur, même plus de chaleur qui se dégage, que le froid et le mépris.
L’odeur qui flotte au réveil dans les chambres est insupportable. Sudations médicamenteuses. Nuits agitées. Cris. Les oreilles aussi sont malades de ces cris. Ça me rend malade. Je voudrais libérer tous ces hommes et ces femmes qui crient. Enfermés pour des conneries. Chambre
d’isolement. Des hurlements incessants. Je ne vois pas comment on va faire pour se sentir
vivants et contents de ce qu’on entreprend. La question ne se pose presque plus. L’entreprise et l’action sont impossibles ici. Tu subis, tu fermes ta gueule et tu quémandes. Si tu émets une
idée qui va contre le bien-être train-train des soi- gnants, isolement. Ils vont pas s’emmerder avec les grumeaux.
L’hôpital psychiatrique, c’est ça : cacher les grumeaux avec comme but ultime de les dissoudre, les atomiser et les œufs en neige seront bien battus. Battus comme certains patients ici.
Battus d’avance, par les vents, les détresses. À plate couture.
I.