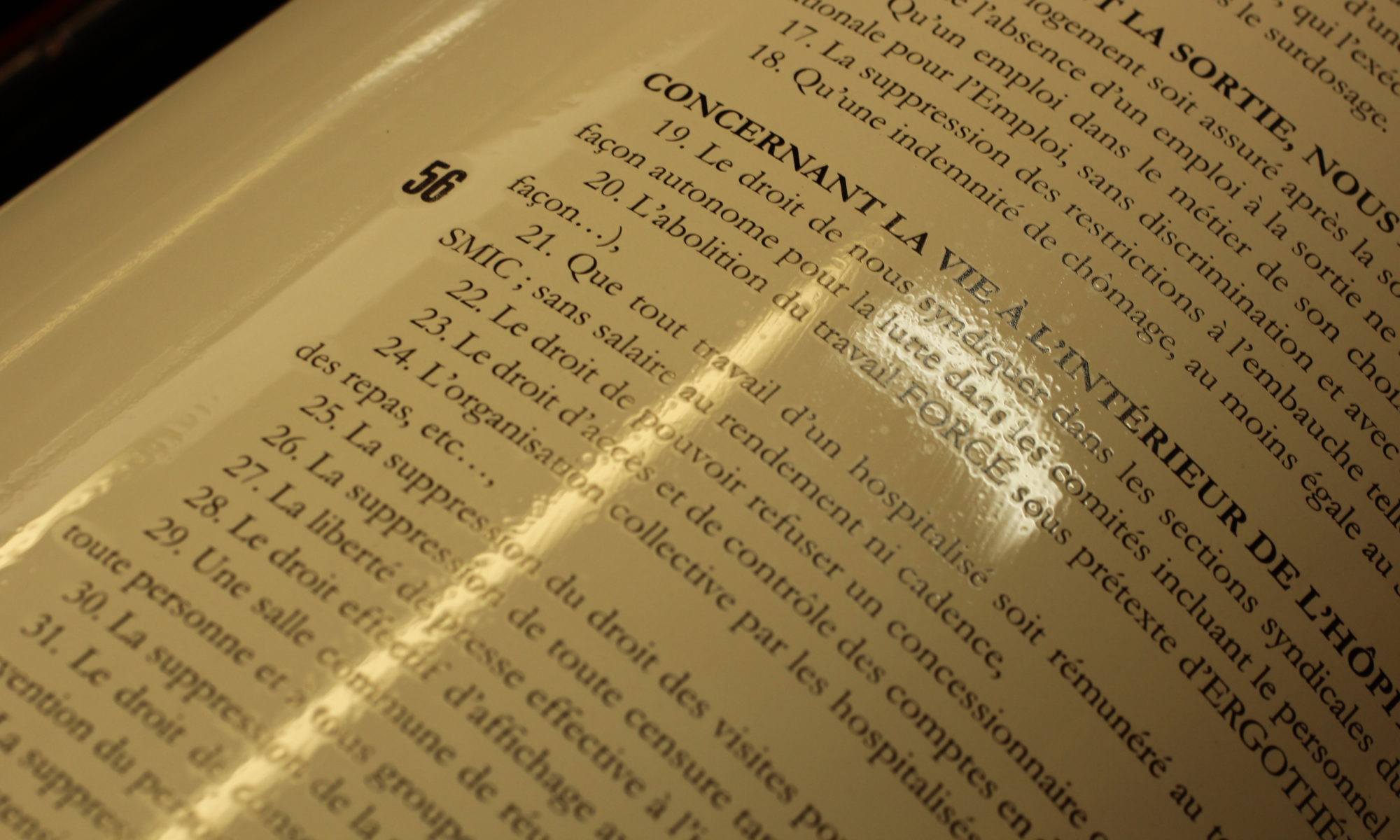L’hôpital psychiatrique n’existe pas que par des murs, il y a une porosité entre intérieur et extérieur qui passe, entre autres, par la réappropriation constante de termes diagnostiques comme « dépression, névrose, TS… », par la préparation d’un terrain favorable labouré depuis l’enfance pour l’acceptation, le respect du savoir médical, la peur de la déviance. La psychiatrie est un pouvoir diffus qui transforme notre monde au nom d’un « bien être social » à grands coups de concepts vaseux et de pilules.
Ceci est une tentative d’exposer ce qui alimente ce pouvoir, ses moyens, ses fins. Comme souvent c’est en les comprenant qu’il est possible de se faire un peu moins écraser. En espérant que ce texte puisse servir à celles et ceux qui se retrouvent confronté-e-s à cet enfermement.
Du problème à l’HP
 Ce qui amène à l’hôpital c’est, paraît-il, une maladie. Mais une maladie psy n’est pas une sorte de réalité qui préexisterait en dehors des personnes ou qui serait valable à n’importe quelle époque ou dans n’importe quelle culture. Ce qu’on appelle une maladie psy, c’est ce que d’éminents savants occidentaux ont réussi à mettre au point en quelques siècles de dissection de cerveaux humains. De l’hystérie à l’ancienne au borderline moderne, on a vachement avancé. Ce qui ne change pas, c’est qu’il y a toujours un monde social qui fabrique et impose une norme. Mais comme dans tout groupe face à toute norme, il y a toujours une possibilité de dévier du chemin. Ne pas le suivre ou ne pas le comprendre conduit à un comportement incohérent dans un monde qui prétend être cohérent, et cela crée une souffrance ou pas. Mais peu importe la souffrance ; si le comportement ou la perception de la réalité est différente, il y aura toujours des psys avec derrière eux la toute puissance scientifique pour diagnostiquer, enfermer, traiter et enfin stabiliser le « cas ». Leur action est à replacer dans le cadre du maintien de l’ordre social centré sur la norme. Il faut donc isoler chaque « cas » pathologique, agir dessus, en transformer l’identité pour qu’elle soit en cohérence avec le monde qui l’entoure. Le projet derrière ses aspects philanthropiques est bien celui d’une hygiène sociale. Il faut traiter le dysfonctionnement : pour ce faire une batterie de catégories existent, tout un tas de symptômes correspondant à des maladies qui, habillés d’effets et de mots, deviennent de plus en plus réels.
Ce qui amène à l’hôpital c’est, paraît-il, une maladie. Mais une maladie psy n’est pas une sorte de réalité qui préexisterait en dehors des personnes ou qui serait valable à n’importe quelle époque ou dans n’importe quelle culture. Ce qu’on appelle une maladie psy, c’est ce que d’éminents savants occidentaux ont réussi à mettre au point en quelques siècles de dissection de cerveaux humains. De l’hystérie à l’ancienne au borderline moderne, on a vachement avancé. Ce qui ne change pas, c’est qu’il y a toujours un monde social qui fabrique et impose une norme. Mais comme dans tout groupe face à toute norme, il y a toujours une possibilité de dévier du chemin. Ne pas le suivre ou ne pas le comprendre conduit à un comportement incohérent dans un monde qui prétend être cohérent, et cela crée une souffrance ou pas. Mais peu importe la souffrance ; si le comportement ou la perception de la réalité est différente, il y aura toujours des psys avec derrière eux la toute puissance scientifique pour diagnostiquer, enfermer, traiter et enfin stabiliser le « cas ». Leur action est à replacer dans le cadre du maintien de l’ordre social centré sur la norme. Il faut donc isoler chaque « cas » pathologique, agir dessus, en transformer l’identité pour qu’elle soit en cohérence avec le monde qui l’entoure. Le projet derrière ses aspects philanthropiques est bien celui d’une hygiène sociale. Il faut traiter le dysfonctionnement : pour ce faire une batterie de catégories existent, tout un tas de symptômes correspondant à des maladies qui, habillés d’effets et de mots, deviennent de plus en plus réels.
Mais comment la maladie passe-t-elle du savoir médical au malade ? Quand le psy le lui dit, tout simplement. On a l’habitude dans notre rapport à la médecine que les constats des médecins renvoient à une entité réelle. La grippe : un virus. Le cancer : les cellules qui s’emballent. Un rhume : les foins. Enfin bref, tout un tas de choses que l’on a vraiment l’impression de comprendre. Et puis quand on est malade, il est tout à fait normal d’aller voir le docteur – docteur c’est déjà rassurant. Pour le psy c’est pareil : la dépression c’est un dérèglement de la chimie dans le cerveau (d’ailleurs on peut maintenant faire une IRM (1) fonctionnelle et vous le montrer (2). Et même si tout ça vous paraît un peu compliqué « ne vous inquiétez surtout pas on va s’occuper de vous ». Le projet semble séduisant. Lors du premier entretien, première rencontre physique entre une personne prédisposée à croire les concepts médicaux et l’autorité psy incarnée, il s’agira uniquement d’actualiser, de donner son consentement à, l’exercice du pouvoir psy. Le soignant prend le contrôle, le consultant est devenu patient. Dans certains cas ce n’est pas si simple il faut quelques outils souvent violents pour que le dispositif devienne effectif. En effet comme la justice, la psychiatrie est un pouvoir qui a les moyens d’enfermer les gens et par- fois pour longtemps.
Quand le médecin pose un diagnostic, l’effet rassurant qu’il est sensé provoquer doit constituer le début de l’acceptation de l’identité de psychiatrisé-e, « je n’ai pas juste une fracture du tibia, je suis un fracturé du tibia, cela me constitue ». Il ne suffira donc pas de régler juste ce « problème », il s’agira de changer toute sa perception de soi pour sortir du problème, c’est bien là le projet fou de la psychiatrie. L’HP est le meilleur lieu pour y parvenir. On y arrive sans trop savoir comment ça se passe : « Bonjour, donnez moi toutes les affaires avec lesquelles vous êtes arrivé, on va les mettre en sécurité, en échange on va vous donner le même uniforme qu’à tous les soignés et une copie du règlement intérieur. Si vous ne voulez pas, très bien, ce sera dehors ou Hospitalisation d’Office (HO) ou Hospitalisation à la Demande d’un Tiers (HDT) ».
L’appropriation de sa nouvelle identité se passera pacifiquement si le patient est coopérant ou avec violence s’il ne coopère pas. L’obligation d’assistance à personne en danger sera toujours là pour justifier le recours à l’enfermement. Ensuite tout est rodé pour obtenir l’accord du patient : une ribambelle d’enfermements, de médicaments, d’électro- chocs mais « tout cela c’est pour votre bien ». Le but étant que vous quittiez la sale identité qui vous a amené-e ici pour prendre celle que l’on vous propose, elle est toute neuve, certes déjà portée par plein de « soignés » avant vous, mais elle a fait ses preuves, plein de gens la portent dehors et ne s’en plaignent pas. « Vous verrez, bientôt vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors vous allez vous soumettre, ava- ler autant de médicaments que l’on jugera bon pour vous. Et surtout vous allez fermer votre gueule sinon on augmentera la dose et vous ne pourrez plus l’ouvrir du tout. »
Hé oui madame ça marche !!!
L’essentiel n’est pas de savoir si le dispositif fonctionne, mais comment il se met en place et quel résultat il recherche. Dès l’entrée dans l’institution, le traitement est administré pour assommer le « patient ». La prescription est ensuite réévaluée pour obtenir un patient calme, n’opposant pas trop de résistance, « stabilisé ». Le but recherché est le lissage du comportement. Quoi qu’il puisse devenir, il faut viser qu’une fois dehors le-la psychiatrisé-e ne dérange pas trop les autres, que personne ne soit obligé de s’occuper de lui-elle en dehors de tous les relais institutionnels. En ce sens les résultats existent, une fois bien traité-e, un-e psychiatrisé-e sera considéré-e comme un-e psychiatrisé-e « stabilisé-e ». Calmer quelqu’un-e en lui donnant à vie un traitement est une sorte de solution. Il n’y a pas de solution possible grâce à l’ HP, le seul choix étant de ressortir différent de comme on y est entré.
Ce constat doit être accepté par le patient lui- même et par son entourage. C’est là un autre travail de l’institution, faire comprendre que le processus est long et violent pour un résultat incertain. Du côté du patient la soumission est facilitée par les médicaments dont les effets sont très vite visibles. Les proches doivent aussi accepter la réalité que quelqu’un qu’ils connaissent, se transforme en patient calme en tenue uniforme. C’est là que le médecin joue son rôle, il « décharge » de la responsabilité de la personne « malade ». Le consentement n’est donc pas très dur à obtenir, même pour des traitements violents. Ce sont donc deux consentements qui sont donnés à l’institution : celui du malade et celui de la famille qui peut aussi servir, si le patient ne se soumet pas, en signant une HDT.
Et alors ?
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se confronter à l’institution psy. Il y a surtout des manières de s’en méfier. Un problème ou une souffrance quelconque ne peut pas se résoudre par une discussion entre amis. La solution si elle existe, reste une exception, la majeure partie des gens confrontés à ce type de problèmes se retrouve à l’HP. En niant la maladie mentale à proprement parler, nous ne pouvons nier pour autant qu’il existe des souffrances psychiques, des choix particuliers. A mon sens, aucune solution n’existe réellement pour y remédier, il y en a juste de moins pires. Il peut à tous nous arriver d’être confrontés à une personne qui va « mal ». Si le recours à la psychiatrie devient inévitable, il faut que ce rapport soit en conscience de ce qu’est cette institution. Le rôle des proches est primordial, il n’y a pas pire que se retrouver abandonné dans un l’HP rempli de gens seuls qui n’ont pas de visite et qui pourrissent là jusqu’à ce que l’hôpital ait besoin de lits. Le rapport à un enfermement doit toujours être de chercher une possibilité d’en sortir.
K.
Notes :
(1) « Le nom complet de l’IRM est en réalité IRMN, Imagerie par Résonnance Magnétique Nucléaire. (…) Cette omission vise essentiellement à ne pas effrayer les patients ». def. Wikipédia. (retour au texte)
(2) « Les troubles bipolaires : de la recherche à la pratique » émission du 03/02/2010, téléchargeable sur le site de RFI. (retour au texte)