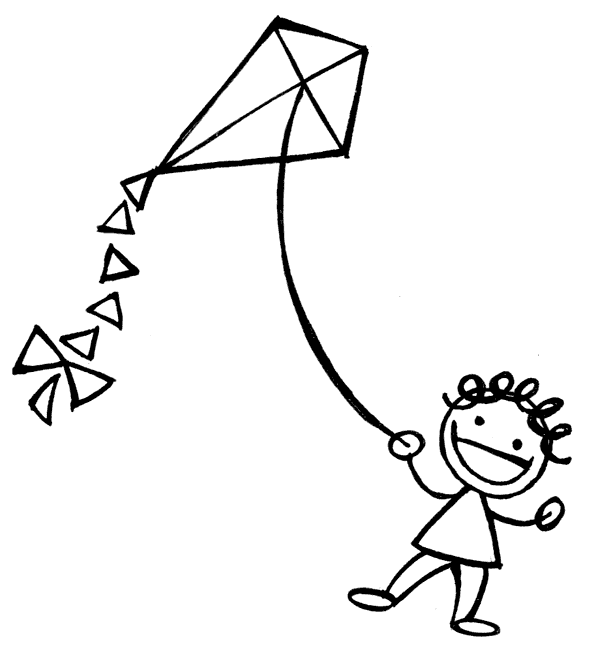Les lignes qui suivent ont été écrites à la suite du procès en appel de Philippe Lalouel, jugé pour trois braquages dans des agences postales, avec une arme volontairement non chargée, et au cours desquels il a dit à chaque guichetière « je ne vous veux aucun mal, je suis là pour l’argent. » (pour plus d’infos à son propos, voir ici)
À l’issue de ce procès, Philippe a été recondamné à dix-sept années de prison, une peine extrêmement sévère au vu des faits qui lui sont reprochés. Pour avoir assisté à cette exécution publique, nous avons la conviction que les expertises psychiatriques et médico-psychologiques ont pesé lourdement dans la balance et nous avons jugé utile de revenir sur leur rôle au sein du tribunal, ce qu’elles sont censées éclairer et ce qu’elles rendent possible.
Dans le cadre d’un procès, le juge d’instruction a « les pleins pouvoirs pour procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité« . C’est dans ce cadre qu’il fait appel à toutes sortes d’experts, sélectionnés sur une liste nationale établie par la magistrature, afin de résoudre toutes les questions d’ordre technique que peut poser l’affaire en jugement. C’est donc avec l’alibi de la rigueur et la neutralité scientifiques que se prononcent les psy, dont les analyses et opinions seront considérées comme relevant de la pure technique et non de l’interprétation (des faits, des mobiles, du comportement de l’accusé au moment de l’examen, etc.).
L’expertise psychiatrique
Distinguons l’expertise psychiatrique et l’expertise médico-psychologique. Ces deux-là se complètent dans le processus judiciaire mais ne font pas appel aux mêmes intervenants et ne remplissent pas la même fonction.
L’expertise psychiatrique n’a qu’un seul rôle : déterminer si la personne mise en cause est « accessible à la peine », c’est-à-dire si elle était en possession de tous ses moyens au moment de l’acte qui lui est reproché et si elle est capable de comprendre le sens de la sanction qui va lui être opposée. Si son jugement était considéré comme totalement aboli, ce qui n’arrive quasiment plus de nos jours, l’accusé ne relèverait plus de la justice pénale et de la prison mais de la psychiatrie et de l’HP, selon un partage des tâches qui date du début du 19ème siècle (voir ici). Ne perdons pas de vue que, à en croire la mythologie que produit à propos d’elle-même l’institution judiciaire, la peine qui est infligée au condamné est censée le faire réfléchir sur ce qu’il est et sur ses actes. Il est donc indispensable qu’un psychiatre valide la capacité de l’accusé à comprendre ce qui se joue. C’est ainsi que, dans le procès de Philippe, ce « spécialiste » est intervenu en chemisette à travers un écran de visioconférence pour affirmer que l’accusé ne souffrait pas de trouble psychiatrique majeur. Pour rendre son diagnostic, le psychiatre s’était contenté de s’entretenir une demi-heure avec lui trois ans avant sa comparution au tribunal… Un rien léger tout de même quand on songe que des années de prison sont en jeu, mais la lecture du dossier d’instruction (incomplet et partial puisque par définition à charge) agrémenté d’une bonne dose de préjugés suffisent apparemment à un expert psy digne de ce nom pour venir à bout de sa périlleuse mission.
 Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte.
Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte.
L’expertise médico-psychologique
L’expertise médico-psychologique arrive à point pour résoudre la question suivante : qui est cet homme ? Et d’ailleurs, est-ce un homme ? L’expert est chargé de fournir des éléments sur la « psychogénèse de la personnalité du criminel ». La « psychogénèse » est le récit qui prétend éclairer les motivations du crime à travers la construction psychologique de celui ou celle qui l’a commis. En réalité, il s’agit plutôt de juger la vie toute entière de l’accusé à l’aune du crime, comme si celle-ci n’était qu’une tragédie toute tendue vers le passage à l’acte.
À travers ce récit est réintroduite la notion de déterminisme, mais cette fois pour mieux accabler l’accusé. Si nos contraintes sociales expliquent bien mieux que d’autres paramètres nos histoires et nos vies, elles seront toujours ici invoquées à charge. Ces déterminismes sont travestis en révélateurs de la nature profonde du criminel. C’est là le tour de force que fabriquent psychiatres et psychologues, de relire la biographie d’une personne, non pas comme la preuve qu’elle est l’objet d’une multitude de contraintes extérieures, mais comme la validation d’une identité criminelle. Lors du procès de Philippe, cela donne, en jargon psy : il a commencé à voler très jeune. Il porte donc en lui cette opposition aux règles. Il n’a jamais voulu changer. Il ne changera jamais. Alors même qu’on pourrait dire : il a grandi seul, dans un milieu pauvre. Très tôt, par nécessité, il a dû se démerder pour trouver des moyens de ramener de la nourriture chez lui.
Le rôle de l’expertise médico-psychologique dans un procès est bien de fabriquer, de produire de toutes pièces une identité qui soit cohérente avec la peine qui va être prononcée. Il serait difficile de dépeindre un pauvre bougre, agi par des réalités sociales qui le dépassent et qui l’écrasent, pour dire ensuite : bon bah, ce sera dix-sept années de prison pour votre origine sociale. Dans le cas de Philippe, il était impératif de construire l’image d’un monstre irrécupérable, pour lequel il ne ferait pas de doute que la seule réponse sociale viable soit la prison à vie – et encore il a bien de la chance que la peine de mort ait été abolie – puisque, de toutes façons, il récidiverait. En effet, l’autre question qui est posée sempiternellement à l’expert psychologue, c’est de savoir s’il y a risque de récidive. Question cruciale, on s’en doute, qui va énormément jouer sur la longueur de la peine. Mais même s’ils sont flattés d’être pris pour des prophètes, il s’avère que les psychologues ne connaissent rien au maniement de la boule de cristal. Ici encore, ils répondent à l’aune de ce qu’ils trouvent dans le dossier d’instruction, de leurs simples intuitions et de leurs opinions préconçues, de ce qu’ils savent qu’on attend qu’ils disent, et aussi, souvent, de leur mépris de classe vis-à-vis de celui qui est dans le box…
Au final, les interventions du psychiatre et du psychologue apparaissent comme parfaitement complémentaires. Le premier a pour mission de démontrer qu’une personne est bien responsable de ses actes et ainsi restaurer sa place parmi la communauté des humains dotés de raison : il faut bien qu’il soit des nôtres pour être jugé. Le second part de ce postulat pour faire sortir de nouveau un accusé du lot de ses semblables et l’enfermer à jamais dans les actes qui lui sont reprochés : finalement, c’est un non-pair, il n’est pas des nôtres et il faut s’en protéger. À jamais dans le cas de Philippe… Que nos deux “spécialistes” tiennent ce rôle en toute conscience de ses effets a finalement bien peu d’importance. Il est toujours possible de dissimuler des préjugés sociaux et des jugements moraux derrière une prétendue neutralité scientifique, mais ces deux-là savent parfaitement que leur “savoir” ne repose pas sur des faits mais sur leur interprétation. Une interprétation est par définition partiale, et celle-ci est d’autant plus biaisée que ce qui est en jeu ici, c’est toute la vie d’un être humain à la seule lumière d’un crime.
À quoi bon cette mascarade grotesque ?
 On pourrait se demander pourquoi on prend la peine de faire jouer aux juges et magistrats cette mascarade longue, coûteuse, et ennuyeuse à souhait alors qu’ils pourraient se contenter de condamner à tour de bras et à huis clos sur la base de leurs propres préjugés et jugements moraux. C’est que toutes ces étapes sont censées concourir au maintien d’une cohésion sociale. Si on en croit la doxa républicaine en vigueur, le tribunal participerait, avec d’autres institutions, à assurer cette cohésion. Par le procès, certains membres, investis d’une fonction magique, rétabliraient symboliquement un ordre social perturbé. Dans cette fable judiciaire, un procès servirait à produire une réparation sociale, mais aussi une réparation pour les victimes. Et tout cela serait traversé par le souci de prononcer une peine individualisée afin de mettre la société à l’abri de la récidive. La société actuelle exigerait réparation des entorses faites aux règles. Et c’est pour faire réparation qu’elle agresse et fait violence, en punissant et enfermant. Cette agression doit être habillée sous un paquet de symboles pour paraître justifiée. Et ce sont les experts psychiatres et psychologues qui sont chargés d’une bonne part de ce travail de camouflage.
On pourrait se demander pourquoi on prend la peine de faire jouer aux juges et magistrats cette mascarade longue, coûteuse, et ennuyeuse à souhait alors qu’ils pourraient se contenter de condamner à tour de bras et à huis clos sur la base de leurs propres préjugés et jugements moraux. C’est que toutes ces étapes sont censées concourir au maintien d’une cohésion sociale. Si on en croit la doxa républicaine en vigueur, le tribunal participerait, avec d’autres institutions, à assurer cette cohésion. Par le procès, certains membres, investis d’une fonction magique, rétabliraient symboliquement un ordre social perturbé. Dans cette fable judiciaire, un procès servirait à produire une réparation sociale, mais aussi une réparation pour les victimes. Et tout cela serait traversé par le souci de prononcer une peine individualisée afin de mettre la société à l’abri de la récidive. La société actuelle exigerait réparation des entorses faites aux règles. Et c’est pour faire réparation qu’elle agresse et fait violence, en punissant et enfermant. Cette agression doit être habillée sous un paquet de symboles pour paraître justifiée. Et ce sont les experts psychiatres et psychologues qui sont chargés d’une bonne part de ce travail de camouflage.
Précisément, un procès d’assises est un cadre particulièrement propice pour entretenir le mythe d’une justice impartiale qui juge au nom du peuple, sans considération de classe, de genre ou de race, puisque ce sont des représentants du peuple qui jugent, tirés au sort sur les listes électorales. La procédure est orale, tout semble se jouer dans l’enceinte du tribunal, comme si tout cela n’avait comme finalité qu’une vocation pédagogique. Ça aurait tout d’un spectacle si les peines distribuées n’étaient pas, quant à elles, bien concrètes et réelles. Les voilà donc, Monsieur, Madame tout le monde, amenés à juger en leur âme et conscience, « sans crainte et sans méchanceté » selon la formule. Pour la crainte, ils peuvent être tranquilles, il y a plus de flics dans la salle que de jurés et de juges réunis. Pour la méchanceté, ils n’en auront même pas besoin, la science a largement fait le travail. Les expertises viendront remplir chaque case de leur jugement moral à deux sous par des concepts hyper sexy du genre « syndrome abandonnique ». Grâce au crédit des experts en blouse blanche, les jurés peuvent se laisser aller à la haine et à la cruauté avec la meilleure conscience du monde. Le tour est joué, en une session d’assises d’une semaine, ils distribuent une bonne centaine d’années de prison, en réponse à la misère sociale des accusés. Ils sont là pour ça, les experts et les juges, permettre aux jurés de condamner sans se sentir coupables. C’est retors, non ?
Et il faut les voir, les jurés, quand les experts causent, là, y’en a du tangible, du réel, pas comme quand l’accusé parle, qui raconte sa version, forcément partiale. Les experts, quant à eux, sont impartiaux, évidemment, puisque, de toutes façons, ils n’ont rien à gagner à ce qu’une grosse peine soit prononcée. Et puis, après tout, ils ont une formation béton de médecin. Un médecin, ça rassure, ça ne veut que du bien aux gens. Nous l’avons vu lors du procès de Philippe : face aux récits des experts, les jurés se réveillent. Ils sont concentrés, prennent des notes, ce qu’ils font très peu le reste du temps. Et se font une opinion, la leur…
Nous ne souscrivons pas à ce discours d’auto-justification qui veut faire passer l’institution judiciaire pour un bien public, une nécessité sociale et l’expression de la volonté populaire alors que celle-ci n’est jamais qu’un instrument de gouvernement au service du pouvoir, et l’expression d’un rapport de classe et d’un ordre de domination. Son rôle évident et premier reste bien d’enfermer, de punir et de servir de repoussoir ou d’épée de Damoclès pour les autres membres de la société. C’est bien de l’organisation de la peur qu’il est question. La vengeance d’État qui s’exerce sur les accusés peut être parée de bien des atours, elle reste assez transparente pour peu qu’on veuille y porter le regard.
Quant aux « victimes », que s’arrachent les juges et les politiciens, il n’est pas dit, pour peu qu’on veuille vraiment les écouter, qu’elles vivent toutes si bien le fait d’être instrumentalisées et dépossédées de leur propre histoire et de la possibilité d’un cheminement singulier vis-à-vis des torts subis. Il s’avère que, quand souffrance il y a eu (ce qui d’ailleurs ne saute pas vraiment aux yeux dans le cas de toutes lesdites victimes de Philippe), la vengeance d’État ne fait pas soin non plus de ce côté-ci de la barre. Les tribunaux ont beau se donner les moyens de rendre définitivement irréconciliables la raison des victimes et celle des accusés, ils n’en sont pas moins traversés par une autre ligne de fracture : celle qui sépare d’une part tous ceux qui se seraient volontiers passés d’être là et d’autre part les professionnels qui en vivent, celle qui oppose les justiciables aux justiciers.
L’expertise au sens large,
ce que fabrique la pratique « expertale »
 La pratique de l’expertise est courante, bien au-delà du tribunal. De la conception au tombeau, on nous observe à travers des prismes réducteurs : du diagnostique prénatal par amniosynthèse à l’expertise pour définir le taux de l’APPA, l’allocation pour personnes âgées, on passe par nombre d’expertises. C’est ce dont aurait besoin l’État pour mettre en œuvre sa politique d’assistance. Il s’agirait de savoir où sont les gens, géographiquement et socialement, et quels sont leurs besoins. Pour se faire, le quadrillage de l’administration est total. Ses mailles se resserrent à mesure qu’on s’approche des classes les plus pauvres, les plus dominées. L’État se dote d’un dispositif complet, sous tutelle d’institutions, qui répertorie toutes les données potentiellement utiles au maintien de l’ordre social. Loin de n’apporter qu’une aide aux nécessiteux comme on essaye de nous le faire croire, ces instances d’expertise réorientent, placent, déplacent, contraignent… Ces contraintes sont autant de déterminations qui nous constituent en tant qu’êtres sociaux. Il n’existe pas un être avec une identité propre qui choisisse en fonction de ses envies ou besoins la personne qu’il veut devenir. Nos identités sociales sont bien plus mues par une prescription continue, ainsi que par la résistance que nous lui opposons. Le pouvoir politique prescrit ce que nous devons être, et ce, en fonction de nos conditions, de notre classe sociale, de notre genre, de notre sexe, de notre âge, de la couleur de notre peau, etc. Et cela détermine l’endroit social où l’on doit pouvoir nous chercher, nous trouver, et comment nous gérer. Notre identité serait pour ainsi dire la somme des déterminations imposées par les expertises successives auxquelles nous sommes soumis.es. On peut commencer par être né.e dans un endroit pauvre, mal maîtriser le français, avoir eu la rougeole à tel âge, avoir été récalcitrant.e à la discipline scolaire, puis avoir bénéficié des minimas sociaux, puis être travailleur.se pauvre, puis être parent isolé.e puis parent démissionnaire et ainsi de suite jusqu’à la mort. À chaque endroit, on trouvera un gentil travailleur social pour valider ce qu’on est. Mais tout ça c’est pour votre bien, vous la voulez cette allocation ou quoi ? Si cela s’organise de cette façon, c’est bien pour des impératifs de gestion de populations à risque. Il s’agirait de prévenir les maux qui peuvent être produits par des situations sociales dangereuses.
La pratique de l’expertise est courante, bien au-delà du tribunal. De la conception au tombeau, on nous observe à travers des prismes réducteurs : du diagnostique prénatal par amniosynthèse à l’expertise pour définir le taux de l’APPA, l’allocation pour personnes âgées, on passe par nombre d’expertises. C’est ce dont aurait besoin l’État pour mettre en œuvre sa politique d’assistance. Il s’agirait de savoir où sont les gens, géographiquement et socialement, et quels sont leurs besoins. Pour se faire, le quadrillage de l’administration est total. Ses mailles se resserrent à mesure qu’on s’approche des classes les plus pauvres, les plus dominées. L’État se dote d’un dispositif complet, sous tutelle d’institutions, qui répertorie toutes les données potentiellement utiles au maintien de l’ordre social. Loin de n’apporter qu’une aide aux nécessiteux comme on essaye de nous le faire croire, ces instances d’expertise réorientent, placent, déplacent, contraignent… Ces contraintes sont autant de déterminations qui nous constituent en tant qu’êtres sociaux. Il n’existe pas un être avec une identité propre qui choisisse en fonction de ses envies ou besoins la personne qu’il veut devenir. Nos identités sociales sont bien plus mues par une prescription continue, ainsi que par la résistance que nous lui opposons. Le pouvoir politique prescrit ce que nous devons être, et ce, en fonction de nos conditions, de notre classe sociale, de notre genre, de notre sexe, de notre âge, de la couleur de notre peau, etc. Et cela détermine l’endroit social où l’on doit pouvoir nous chercher, nous trouver, et comment nous gérer. Notre identité serait pour ainsi dire la somme des déterminations imposées par les expertises successives auxquelles nous sommes soumis.es. On peut commencer par être né.e dans un endroit pauvre, mal maîtriser le français, avoir eu la rougeole à tel âge, avoir été récalcitrant.e à la discipline scolaire, puis avoir bénéficié des minimas sociaux, puis être travailleur.se pauvre, puis être parent isolé.e puis parent démissionnaire et ainsi de suite jusqu’à la mort. À chaque endroit, on trouvera un gentil travailleur social pour valider ce qu’on est. Mais tout ça c’est pour votre bien, vous la voulez cette allocation ou quoi ? Si cela s’organise de cette façon, c’est bien pour des impératifs de gestion de populations à risque. Il s’agirait de prévenir les maux qui peuvent être produits par des situations sociales dangereuses.
Historiquement, il s’est opéré un glissement de la gestion de la dangerosité à l’identification des facteurs de risque. On le voit bien dans les tribunaux, avec cette volonté de gestion des individus dangereux, avec l’aide des experts psy. À cela s’ajoute l’identification de facteurs de risque d’une population donnée par les travailleurs sociaux chargés du repérage. On voit la langue de l’administration prendre le pas sur le langage psychiatrique. Avec les « personnes dangereuses », la justice est condamnée à attendre le délit pour agir. Avec le risque s’ouvre un champ d’action beaucoup plus large. C’est plus simple, on peut dire : au vu de ce qu’est cette personne, elle passera probablement à l’acte, elle est potentiellement dangereuse. Citons l’un des médecins qui a expertisé Pierre Rivière : « Inoffensifs aujourd’hui, ils peuvent devenir dangereux demain. » (1) Cela pourrait être la maxime des experts du médico-social.
Donc les médecins, plutôt que d’attendre, permettent l’interventionnisme dans le monde social. Et c’est avec des outils statistiques et de probabilités qu’ils vont travailler à chercher la fréquence des maladies mentales et autres anomalies dans les couches les plus défavorisées de la population.
C’est de cette volonté de réformer le fond immoral des endroits les plus sombres de la société que pourront naître les idées d’eugénisme du 20ème siècle, mais ce n’est pas l’objet de cet article.
Aujourd’hui on a basculé dans un nouveau modèle de surveillance. Le dépistage de tout un tas de « risques », que nous lisons comme des conditions sociales, s’organise au fur et à mesure de notre vie, de la naissance à l’école en passant par le monde du travail. La violence de l’expertise se dissout par un grand nombre de passages dans les administrations de dépistage, de repérage des maladies ou des déviances. On voit là l’efficacité d’une surveillance organisée pour être à la fois extérieure et intériorisée. C’est l’idée d’une coprésence constante de la surveillance et du contrôle. Où l’on est toujours regardé.e, expertisé.e dans son comportement moral et social. Même s’il est vrai que certaines instances d’expertise s’invisibilisent par leur présence sociale constante, elles se surajoutent aux instances telles que la famille, le travail, l’école, la psychiatrie ou la psychologie qui agissent sur nous toujours et encore de manière active et visible.
Il existe donc une forme de gestion des risques qui concourt au fameux mythe de l’éradication complète du risque. Elle opère en immisçant son regard dans tous les endroits du monde social pour produire des schémas prescriptifs très précis. C’est la grande utopie de l’hygiénisme qui doit être réalisée par tous les pans de l’assistance d’État, par toutes ses institutions.
Ce que l’on pouvait lire comme des activités soignantes ou d’aide sociale uniquement, apparaît aussi clairement comme activités d’expertise et de repérage. Les expertises ont bien pour fonction de réassigner à une place définie un individu dans son groupe. Et cela en regard de ce que cet individu est supposé être à travers toutes les grilles d’expertises superposées, qui lui sont imposées, à tous les moments de sa vie, sous l’alibi de l’assistance.
K. & J.
 Notes :
Notes :
(1) À propos de Pierre Rivière, Cf. ici et le livre collectif Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, Folio, 1973. (retour au texte)
 Sans remède est composé d’ anti-professionnel.les de la santé et du social.
Sans remède est composé d’ anti-professionnel.les de la santé et du social.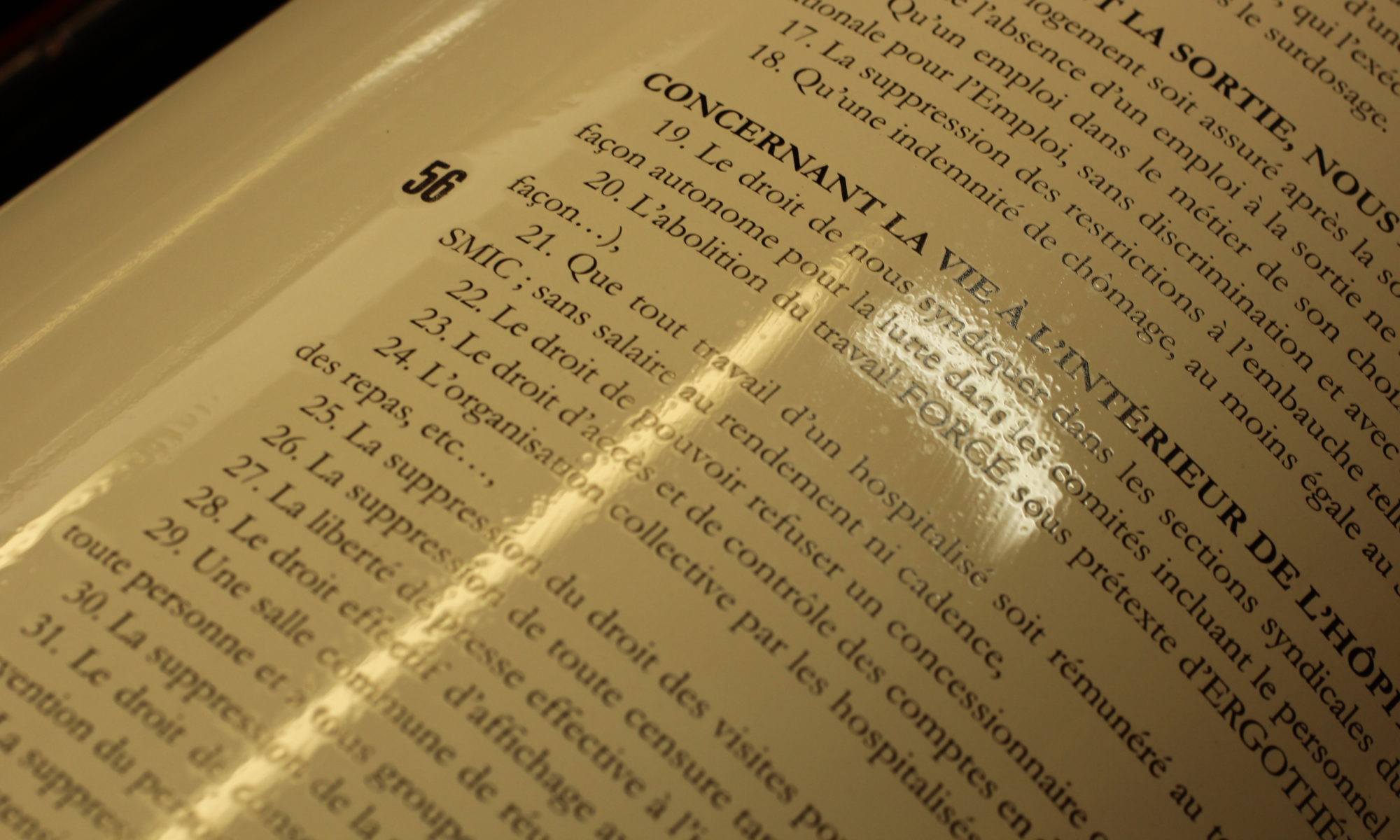











 Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte.
Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte.